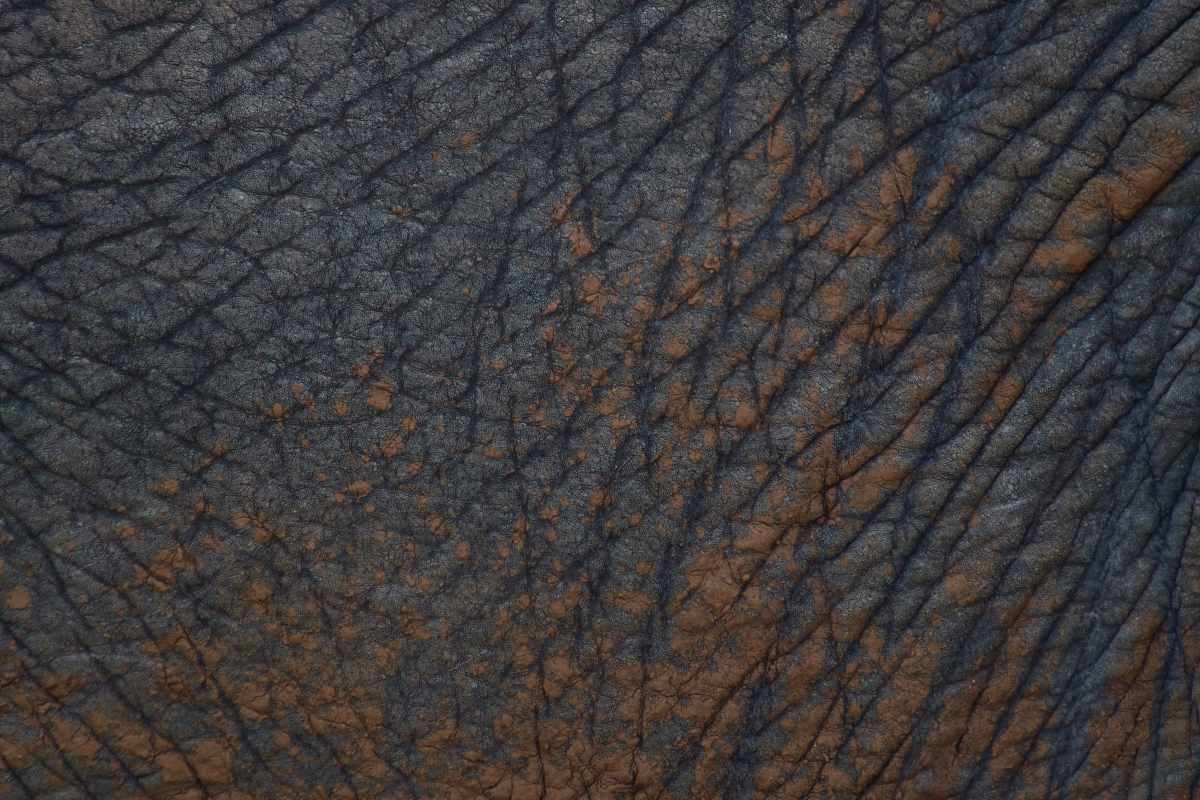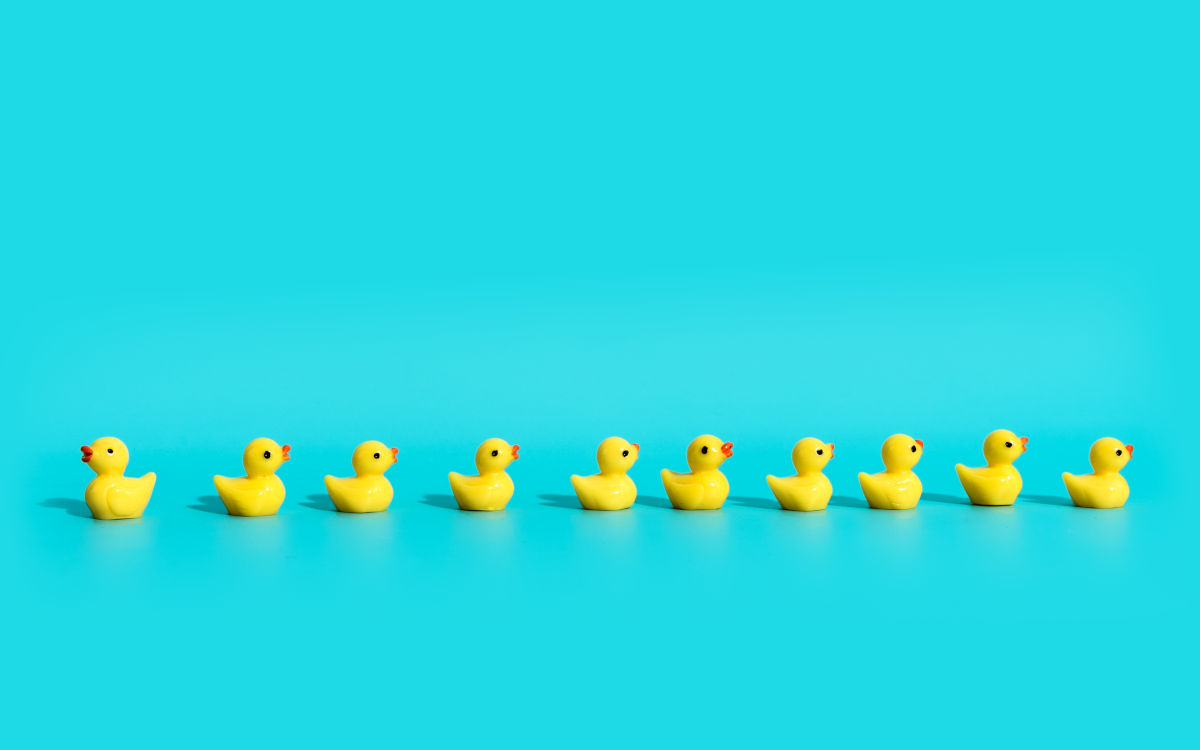Ce que je vous dis ici, quelqu’un l’a déjà dit avant — et sans doute mieux que moi.
Mais je ne le dis pas ici pour assouvir le besoin narcissique de me trouver original. Je vous le dis parce que je crois que ça a besoin d’être entendu, par vous mes amis, ici et maintenant.
D’autant plus élevée la probabilité de vous servir du remâché si par chance je me trouve à me rapprocher de la vérité — car il existe peu de choses comme la faculté d’entendement, qui se partage plus vite que la vitesse de la lumière sans jamais rencontrer la moindre résistance dans tout l’univers.
+++
La pensée critique n’a pas d’autonomie. Elle ne surgit pas comme ça de la caboche de tel individu particulièrement intelligent, ou de tel autre spécialement doué pour la polémique. Elle s’inscrit en compréhension radicale¹ au travers du lent développement historique de la contradiction déchirante qui plonge les délicats rapports humains dans l’eau bouillante et tourbillonnante de leurs rapports de production — lesquels modèlent et remodèlent constamment leur existence.
Il ne peut y avoir de pensée critique sans conscience historique. Elle ne s’invente pas : on la puise dans l’histoire pour en poursuivre la course. Elle est le souffle brûlant d’une inextinguible volonté de vivre qui se transmet d’une génération à une autre — de celles qui ont eu le courage de se tenir debout jusqu’au bout à celles qui ont la volonté de vivre en se tenant debout jusqu’au bout.
+++
Pour vous donner sans autre formalité un exemple du caractère décisif de la conscience historique pour que la pensée puisse avoir quelque fondation, quelque prise sur la réalité, quelque effectivité, faisons immédiatement voler en éclat cette redondante illusion selon laquelle « les choses étaient mieux avant » et qu’elles seraient parties en couille parce que, à un certain moment donné, des gens mal intentionnés se seraient emparés du pouvoir.
Il suffit de considérer cette citation limpide de Bertrand de Mandeville, datant de pas plus tard que 1728, pour comprendre que c’est tout le système politique qui est pourri par essence, que l’horreur de l’exploitation, loin d’être le produit d’un malheureux accident de parcours, est bien plutôt la précondition de ce système, et qu’un tel système n’a finalement rien fait d’autre que poursuivre son développement selon les lois et la logique qui lui sont propres :
Là où la propriété est suffisamment protégée, il serait plus facile de vivre sans argent que sans pauvres, car qui ferait le travail ? . . . S’il ne faut donc pas affamer les travailleurs, il ne faut pas non plus leur donner tant qu’il vaille la peine de thésauriser. Si ça et là, en se serrant le ventre et à force d’une application extraordinaire, quelque individu de la classe infime s’élève au-dessus de sa condition, personne ne doit l’en empêcher. Au contraire, on ne saurait nier que mener une vie frugale soit la conduite la plus sage pour chaque particulier, pour chaque famille prise à part, mais ce n’en est pas moins l’intérêt de toutes les nations riches que la plus grande partie des pauvres ne reste jamais inactive et dépense néanmoins toujours sa recette . . . Ceux qui gagnent leur vie par un labeur quotidien n’ont d’autre aiguillon à se rendre serviables que leurs besoins, qu’il est prudent de soulager, mais que ce serait folie de vouloir guérir. La seule chose qui puisse rendre l’homme de peine laborieux, c’est un salaire modéré. Suivant son tempérament, un salaire trop bas le décourage et le désespère, un salaire trop élevé le rend insolent ou paresseux . . . Il résulte de ce qui précède que, dans une nation libre où l’esclavage est interdit, la richesse la plus sûre consiste dans la multitudes des pauvres laborieux. Outre qu’ils sont une source intarissable de recrutement pour la flotte et l’armée, sans eux il n’y aurait pas de jouissance possible et aucun pays ne saurait tirer profit de ses produits naturels. Pour que la société [qui évidemment se compose des non-travailleurs] soit heureuse et le peuple content même de son sort pénible, il faut que la grande majorité reste aussi ignorante que pauvre. Les connaissances développent et multiplient nos désirs et moins un homme désire, plus ses besoins sont faciles à satisfaire².
+++
C’est seulement après s’être débarrassé de ses innocentes illusions — notamment sur la portée fantasmée de l’organisation politique — que l’on peut envisager commencer à comprendre ce qui nous arrive. Et la bonne nouvelle, c’est que l’histoire nous apporte, au travers les soubresauts incendiaires de pensée critique qui surgissent organiquement en elle, un patrimoine inépuisable de compréhension radicale, déjà toute pesée, jaugée, éprouvée à la flamme vive du combat — et prête à l’emploi.
La tâche que je me donne ici n’est pas de vous présenter une perspective originale de mon propre cru, mais bien plutôt de vous inviter à puiser à même la réserve de mémoire historique qu’ont produit les développements qui nous ont menés où nous sommes pour en extraire ce qui pourra nous servir, sans délai, à nous qui refusons de vivre dans la résignation, le repli sur soi et/ou l’attente nécessairement déçue de solutions politiques qui ne pourront de toute façon jamais venir.
Photo : Wolfgang Hasselmann
___
- Ici, je prends la notion de radicalité au sens de l’étymologie du mot : qui va à la racine des choses (plutôt que de demeurer à la surface).
- B. de Mandeville : The Fable of the Bees, 5e édition, Londres, 1728, Remarks, p. 212, 213, 328 [tel que cité, souligné et annoté par Karl Marx dans Le Capital, Livre I, à la « fameuse » Section VII, Chapitre XXV, Éd. Sociales, Paris, 1977, pp. 438 à 439. Marx cite encore l’auteur dans sa note bibliographique, p. 676 : ] « Une vie sobre, un travail incessant, tel est pour le pauvre le chemin du bonheur matériel [l’auteur entend par « bonheur matériel » la plus longue journée de travail possible et le minimum possible de subsistances], et c’est en même temps le chemin de la richesse pour l’Etat [l’Etat, c’est-à-dire les propriétaires fonciers, les capitalistes et leurs agents dignitaires gouvernementaux]. » (An Essay on trade and commerce, Londres, 1770, p. 54.)